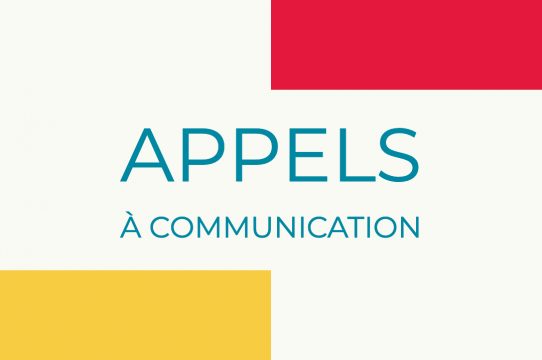[Appel à communication] Colloque « Des liens aux réseaux du sang : controverses scientifiques et réactions sociétales. Europe occidentale, XVIe-XXe siècles »
DATE LIMITE DE SOUMISSION : 15 JANVIER 2026
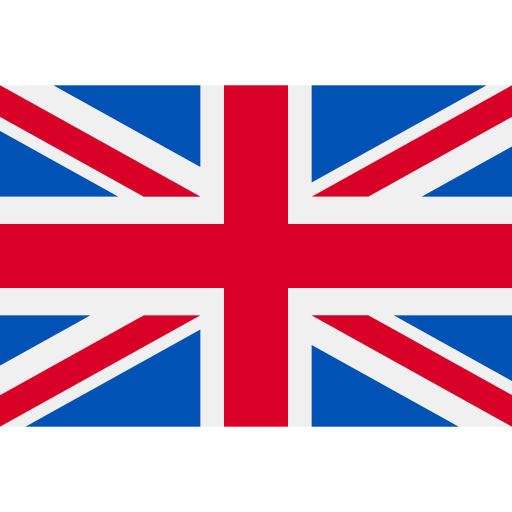
Colloque organisé par l’Université Sorbonne Paris Nord / UR PLEIADE et l’Institut de l’histoire des sciences de l’Académie polonaise à Varsovie les 12 et 13 novembre 2026
RÉSUMÉ
Le sang est un objet d’étude qui a traversé les siècles en raison de ses enjeux scientifiques et sociétaux. Ce fluide vital est vecteur de croyances et, dans certains cas, utilisé comme marqueur social indélébile. Il crée des tensions, des ostracismes, souvent avec le concours complice des instances de savoir ou de pouvoir.
La question est de déterminer en quoi le discours savant, traditionnel ou innovant, et les représentations populaires ont pu se mélanger ou, au contraire, se distinguer radicalement. Dans certains cas, les découvertes et les ruptures en termes de réception et de vision autour du sang et des liens qu’il génère ont pu conduire à des controverses intenses, parce qu’à l’encontre de conceptions traditionnelles jugées incontestables. Des discours savants se sont opposés, des réseaux se sont mobilisés. Changer la perception du sang des femmes, des étrangers ou des malades n’était pas sans conséquence. Mais, en l’état, ces turbulences autour d’un sang dont les qualités sont à reconsidérer sont encore mal connues.
Objectif du colloque
Nous souhaitons ouvrir cette réflexion à une large communauté de chercheur/ses : historiens et historiennes de la médecine et de la santé, spécialistes en hématologie, en génétique, mais aussi philosophes, ethnologues et sociologues. Cette diversité disciplinaire est indispensable pour comprendre la richesse des polémiques nées autour des « réseaux du sang » et la manière dont elles ont fait évoluer à la fois les savoirs, les pratiques, les gestes et les sensibilités.
Nous aborderons, du point de vue des sciences humaines et sociales, les réseaux qui ont pu jouer un rôle autour des controverses relatives aux liens du sang dans leurs dimensions sociales, politiques et scientifiques. La diversité des normes, des espaces, des discours et des acteurs concernés ne sera pas éludée, bien au contraire. Nous nous interrogerons aussi sur la manière dont la compréhension des liens biologiques et familiaux, rendue possible par la génétique, a transformé, depuis plus d’un siècle, la définition normée et genrée de la « santé » (prise en charge des maladies héréditaires, anticipations thérapeutiques, nouvelles stratégies de soin). Cela nous permettra de mieux comprendre comment ces connaissances, plus ou moins bien acceptées, plus ou moins bien diffusées, ont contribué à transformer le rôle du sang et de ce qu’il contient dans le maintien de la cohésion familiale (l’ancien modèle aristocratique lié au fantasme de la pureté du sang résistait mal à la réalité des naissances « monstrueuses ») face à la maladie.
Zone géographique concernée : Europe méditerranéenne, occidentale et orientale.
Temporalité : XVIe-XXe siècles (période allant des premières théories sur la circulation sanguine aux premières percées scientifiques sur la génétique).
Thèmes abordés
- Liens du sang, théories hématologiques et communautés savantes en opposition
- Savoirs hématologiques et normes religieuses : une confrontation sous-estimée ?
- Expressions des sensibilités populaires au fil des progrès et des connaissances scientifiques sur le sang
- Représentations des liens du sang comme sujet polémique dans les textes et les arts
Les objectifs que nous nous sommes fixés sont les suivants :
- Comprendre l’impact des réseaux scientifiques européens dans les recherches sur les questions du sang et le développement des pratiques de santé qui s’y réfèrent
- Comprendre l’incidence des découvertes scientifiques sur le sang sur les inégalités sociales et la perception des pauvres, de certains malades ou des étrangers
- Observer la diversité des acteurs mobilisés pour améliorer la recherche sur le sang
- Repenser l’être et la santé au fil des découvertes scientifiques sur le sang (préjugés et divisions des sociétés)
- Redéfinition des liens sociaux et des rapports entre les sexes en fonction des évolutions des connaissances sur le sang (sang menstruel, ménopause)
- Comprendre comment fut instrumentalisée la question du sang durant les crises sanitaires et sociales par les autorités publiques
Nous proposons d’articuler notre approche à travers quatre axes :
- Les notions de liens et de réseaux du sang : théories et pratiques
- La circulation des idées et des connaissances scientifiques sur le sang
- La projection de représentations sur le sang et leurs évolutions
- Les tensions scientifiques, politiques et sociétales au sujet du sang et des réseaux qu’il crée
Mots-clés thématiques
Sang, savoirs, normes, controverses, représentations.
Date limite de soumission
Les propositions de communication (300-400 mots) en français, en anglais ou en polonais, accompagnées d’une courte notice biographique, sont à envoyer d’ici le 15 janvier 2026 à
sabrina.juillet-garzon@sorbonne-paris-nord.fr, renata.paliga@ihnpan.pl, sarah.pelletier@univ-paris13.fr, stanis.perez@univ-paris13.fr
Autres appels
AAC – De quelles peurs le genre est-il le nom ?
De quelles peurs le genre est-il le nom ?DATE LIMITE DE SOUMISSION : 7 JANVIER 2026 RÉSUMÉ Nous interrogeons les…
Trouble dans la cartographie Contre-cartographie et changements de paradigme
Trouble dans la cartographie Contre-cartographie et changements de paradigmesDATE LIMITE DE SOUMISSION : 1ER DÉCEMBRE 2025 RÉSUMÉ La cartographie est…
AAC – Intime et psyché : discours et représentations de la vie intérieure dans l’Europe de la première modernité
Intime et psyché : discours et représentations de la vie intérieure dans l’Europe de la première modernitéDATE LIMITE DE SOUMISSION :…
Maraîchage et arbres fruitiers en milieu urbain et péri-urbain : enjeux socio-environnementaux et problématiques d’aménagement
Maraîchage et arbres fruitiers en milieu urbain et péri-urbain : enjeux socio-environnementaux et problématiques d’aménagementAppel à communication – Date limite…
AAC Collectifs : mémoires, discours, territoires
Colloque Collectifs : mémoires, discours, territoires Appel à communication – Date limite : 15 juin 2025 À partir de terrains d’étude variés,…