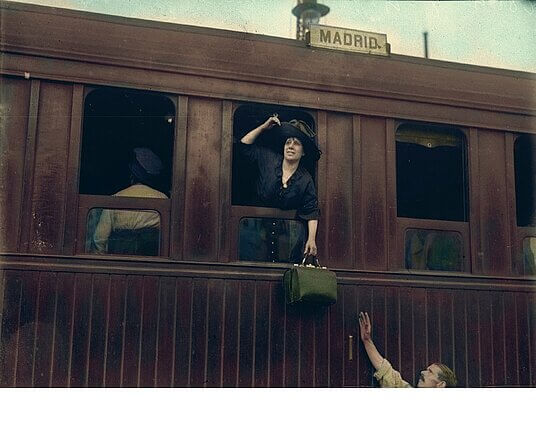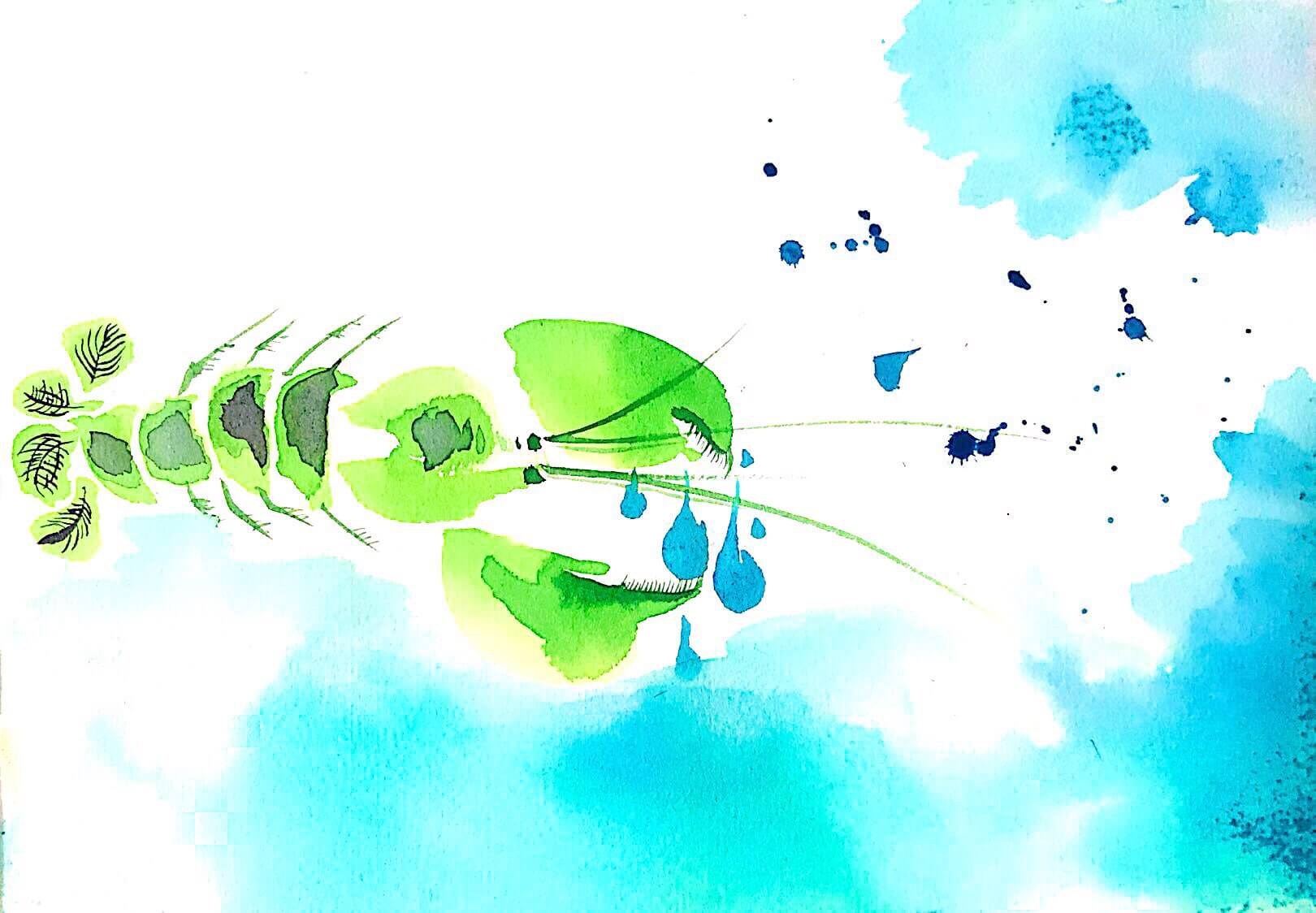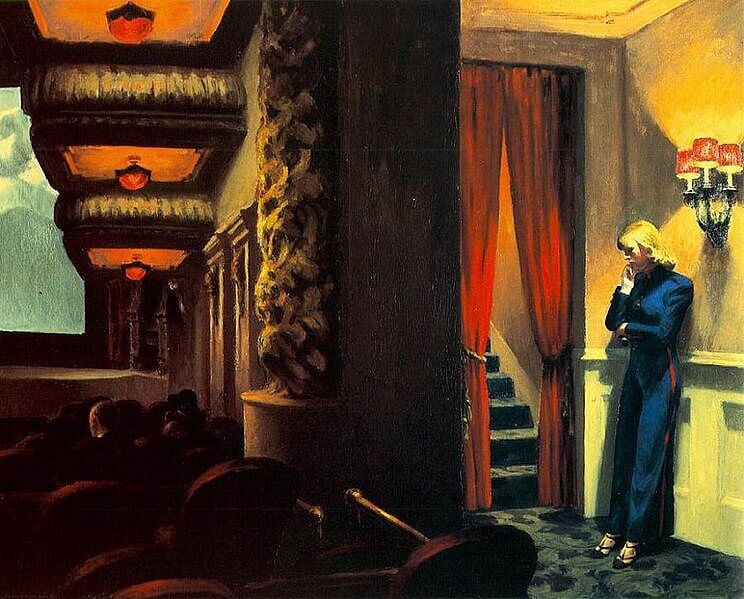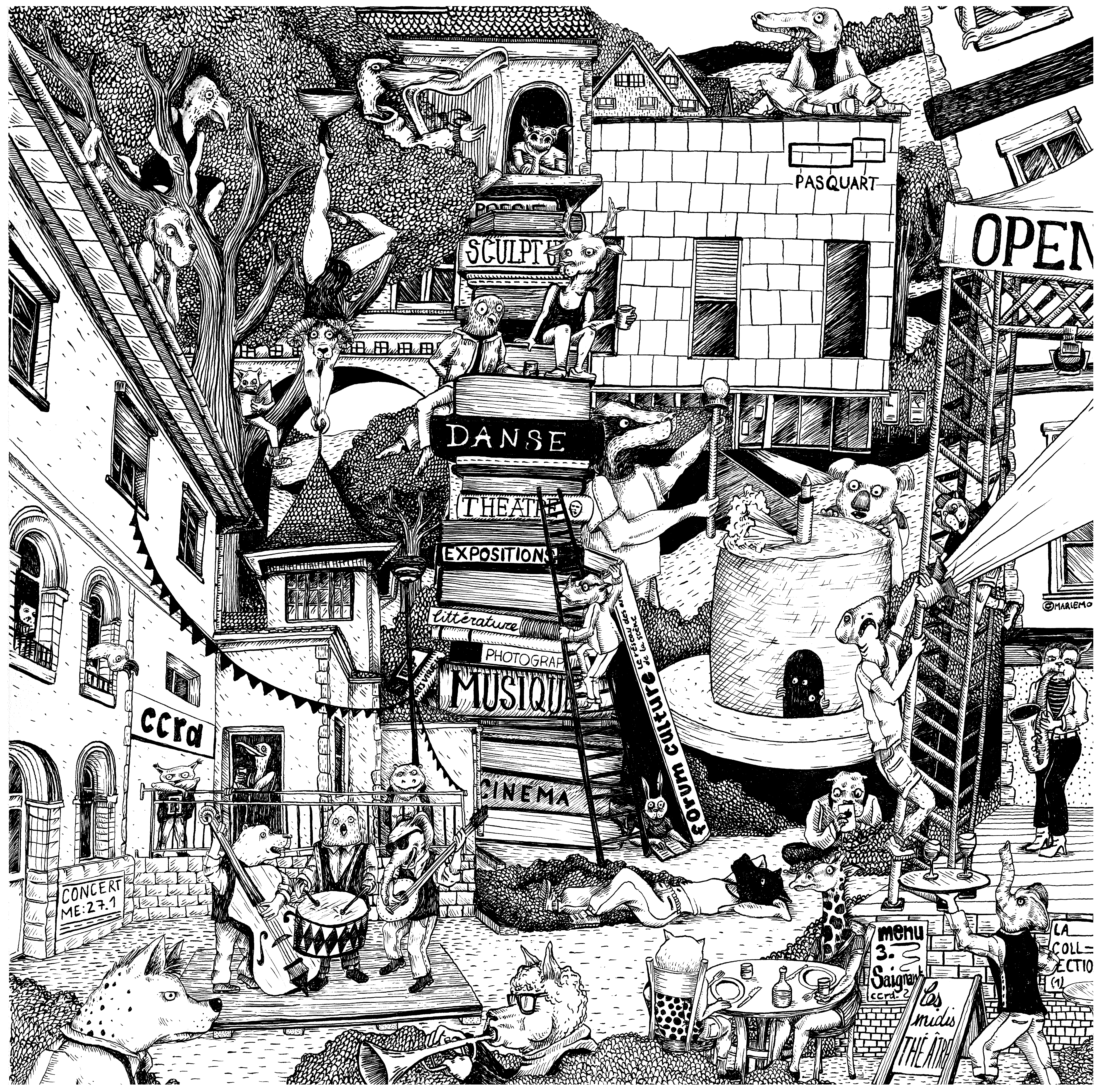Circulation des normes et altération des identités : ouverture à la modernité ou repli sur soi ?
1) Les évolutions du Droit dans un monde interconnecté
2) Normes et variations : langues, usages, sociétés
3) La littérature, entre normes esthétiques et créativité
4) Sacré et profane, ordre social et contestation.
Université d’Al-Azhar, Le Caire, 9-11 janvier 2024.
Lien : https://cerla.univ-lyon2.fr/activites/colloques-et-journees-detude-2.
Université d’Al-Azhar (Centre d’Al-Azhar pour l’enseignement du français), Université de Lyon 2, Université de Paris 13, Institut national des langues et civilisations orientales (Paris).
****
Le thème global du colloque vise à réfléchir à la mondialisation et à ses incidences sur les individus (avec leurs appartenances et sensibilités), les sociétés (dans leurs fonctionnements et croyances), les États (par rapport à leurs processus de légitimation), et ce à travers la circulation des normes, entendues de manière large. La question posée, à laquelle chaque participant tentera d’apporter des réponses est de savoir si cette circulation mondialisée des normes pousse vers la modernité (concept qu’il sera nécessaire de définir) ou au contraire vers un rejet de celle-ci, et conséquemment vers un repli sur les traditions, les coutumes, les modes anciens de fonctionnement. Naturellement, les perceptions de la mondialisation et de la modernité varient selon les lieux et les circonstances, ce qui donne au colloque toute sa pertinence : savoir, comprendre, respecter, aimer, dans la diversité culturelle, telles doivent être les postures épistémologiques qui animeront le colloque, mais toutefois sans complaisance, avec donc des analyses sérieuses.
Université d’Al-Azhar, Le Caire, 9-11 janvier 2024.
Lien : https://cerla.univ-lyon2.fr/activites/colloques-et-journees-detude-2.
Contacts : Mona SABRY (Université d’Al-Azhar), monasabry2002@yahoo.fr + mona.sabry@azhar.edu.eg et Stéphane VALTER (Université de Lyon 2), s.valter@univ-lyon2.fr.
Université d’Al-Azhar (Centre d’Al-Azhar pour l’enseignement du français), Université de Lyon 2, Université de Paris 13, Institut national des langues et civilisations orientales (Paris)
****
L’idée première de ce colloque est de permettre à des enseignants et chercheurs occidentaux de rencontrer leurs homologues égyptiens et arabes, puis d’échanger sur un thème à la fois général et précis. Assez général pour aborder différentes questions (juridiques, linguistiques, littéraires, sociologiques) et également assez précis pour bien cibler la réflexion. Le thème global du colloque vise à réfléchir à la mondialisation et à ses incidences sur les individus (avec leurs appartenances et sensibilités), les sociétés (dans leurs fonctionnements et croyances), les États (par rapport à leurs processus de légitimation), et ce à travers la circulation des normes, entendues de manière large.
La question posée, à laquelle chaque participant tentera d’apporter des réponses est de savoir si cette circulation mondialisée des normes pousse vers la modernité (concept qu’il sera nécessaire de définir) ou au contraire vers un rejet de celle-ci, et conséquemment vers un repli sur les traditions, les coutumes, les modes anciens de fonctionnement. Naturellement, les perceptions de la mondialisation et de la modernité varient selon les lieux et les circonstances, ce qui donne au colloque toute sa pertinence : savoir, comprendre, respecter, aimer, dans la diversité culturelle, telles doivent être les postures épistémologiques qui animeront le colloque, mais toutefois sans complaisance, avec donc des analyses sérieuses.
Les échanges se feront essentiellement en arabe et en français, et peut-être dans d’autres langues, avec une traduction. Cette variété langagière se veut le reflet du respect à accorder à tous les points de vue, sans privilégier une forme quelconque de références culturelles. Le but du colloque est, pour conclure, de dresser un tableau précis et général (même s’il n’est pas exhaustif) des échanges et influences de tous ordres entre le monde arabo-islamique et l’Occident, à travers la circulation (ou son absence) des normes, concept qui inclut les idées, les règles, les lois, les codes, les canons, les représentations, etc.
****
Les évolutions du Droit dans un monde interconnecté
Axe 1 sous la responsabilité du Professeur Didier GUÉVEL (Université de Paris 13), du Professeur Fouad AL-NADI (Université d’Al-Azhar) et du Professeur Ahmad AL-EZABY (Université d’Al-Azhar) :
L’interconnexion, généralisée et exacerbée dans notre monde contemporain, n’a pas créé, à notre sens, de nouvelles modalités d’interactions entre les normes juridiques mais elle a sans doute favorisé et accéléré les phénomènes déjà existants. Une ample diffusion des informations relatives aux normes étrangères a pu aider à leur connaissance et à leur introduction ; mais l’absence de contrôle des sources de ces données et leur présentation par des personnes non expertes a pu être à l’origine de bien des incompréhensions. C’est probablement ce qui peut expliquer certaines évolutions du Droit français et ce de cinq points de vue différents : les mots du Droit, les procédés normatifs, les organes « normateurs », le contenu des normes et, enfin, leur ressort (tant géographique que populationnel, avec la question des règles supranationales). Enfin, faut-il plus parler des droits de l’Homme ou au contraire des devoirs humains ?
Normes et variations : langues, usages, sociétés
Axe 2 sous la responsabilité du Professeur Thomas SZENDE (INALCO, Paris), de la Professeure Soheir HAFEZ (Université d’Al-Azhar) et de la Professeure Mona SABRY (Université d’Al-Azhar) :
Cet axe tournera autour des idées suivantes : premièrement, l’enseignement des langues (et des cultures étrangères), qui a pour ambition de permettre à la fois la juste interprétation des messages et la production de messages appropriés, se doit de spécifier le statut social des éléments de la langue. Or, aucune langue n’échappe aux phénomènes de variation qui affectent le lexique, mais aussi toutes les structures morphosyntaxiques et phonétiques, qui constituent la personnalité d’une langue. Dans le même temps, la diversité des usages ne doit pas masquer la réalité des normes. Et l’existence de pratiques langagières différentes n’empêche pas les locuteurs d’avoir la conscience d’une forme d’appartenance à une communauté linguistique. Par ailleurs, la variabilité n’est pas entièrement libre car en l’absence d’un code commun à tous les locuteurs, la communauté linguistique n’existerait pas et la communication ne pourrait pas y être assurée.
La prise en compte de la variation pose ainsi le problème de la norme. Enseigner les structures de toute langue signifie : retenir un cadre de référence homogène et le plus commun possible à l’ensemble des locuteurs. C’est ainsi que dans l’apprentissage de tout système linguistique, le rapport à la norme joue un rôle particulièrement important. La norme linguistique est un processus social construit auquel le public de bonne instruction reste attaché et que l’enseignement s’efforce de maintenir. Reconnaître la norme, c’est d’abord se soumettre aux conventions de la société qui « sanctionne » les erreurs, et c’est aussi en connaître la marge de tolérance ; or, celle-ci peut être variable selon le type de phénomène. Parvenir à s’exprimer dans une langue revient à savoir opérer une sélection parmi les formes linguistiques possibles, savoir élaborer et exposer ses idées compte tenu de toutes les circonstances qui les motivent.
La littérature, entre normes esthétiques et créativité
Axe 3 sous la responsabilité du Professeur Denis PERNOT (Université de Paris 13) et de la Professeure Salwa LOTFI (Université d’Al-Azhar)
Dans ses avatars les plus institutionnalisés, le discours critique français a longtemps évalué les productions littéraires en fonction du respect de normes esthétiques (génériques, stylistiques, prosodiques, etc.) et sociales (bienséance, etc.) envisagées comme le produit d’une tradition nationale. Celle-ci s’est sentie menacée à partir du moment où, d’une part, des œuvres traduites de l’étranger ont connu le succès (roman russe, théâtre scandinave, etc.), où des écrivains étrangers ont écrit la France, pour certains d’entre eux en français, et où, d’autre part, les écrivains français ont voyagé, traduit leurs confrères d’ailleurs, célébré des œuvres venues de l’étranger, d’un étranger de plus en plus lointain. Dans les secteurs dominés du champ littéraire, l’étranger a en revanche été vu comme le vecteur d’un renouvellement des normes et des représentations, d’un renouveau de créativité. Défendant une normativité révolue ou des transgressions d’importation, ces positions doivent-elles être opposées l’une à l’autre ? Voyageur, migrant, exilé ou hôte de passage, l’écrivain qui s’exprime dans la langue de sa terre d’accueil, en faisant ainsi sa patrie d’élection créative, reste-t-il un étranger de l’intérieur au sein de la tradition littéraire où il fait entendre sa voix ? À quel prix, en matière de représentations de soi et des autres, sa naturalisation littéraire peut-elle avoir lieu ? Qu’en est-il à l’heure de la mondialisation des littératures nationales ? Se fondent-elles en une vaste littérature-monde subdivisée en aires linguistiques ? Y a-t-il lieu de parler d’œuvres métèques ou métisses ? Sans prétendre répondre à d’aussi complexes questions, il conviendrait de s’intéresser :
- à divers cas de naturalisation littéraire, de s’interroger sur les écritures qui les portent vis-à-vis des attentes normatives de traditions nationales données ;
- à des écrivains évoquant leurs expériences de l’ailleurs dans la langue de l’étranger qui les a accueillis et de réfléchir aux images de leur identité qu’ils ont construites en les faisant jouer vis-à-vis d’images, clichées ou renouvelées, de leur terre d’accueil ;
- aux instances, confrères, revues, journaux, réseaux de sociabilité, qui ont permis à des écrivains venus d’ailleurs de trouver, une écoute, dont la nature doit être interrogée, au sein du champ littéraire national où ils ont souhaité être reconnus et /ou au sein du champ littéraire de leur terre d’origine.
Sacré et profane, ordre social et contestation
Axe 4 sous la responsabilité du Professeur Stéphane VALTER (Université de Lyon 2) et du Professeur Nazir AYAD (Complexe d’Al-Azhar pour les Recherches Islamiques)
La notion de sacré est vaste. Elle signifie bien sûr les croyances et pratiques religieuses, mais aussi plusieurs choses – concrètes ou abstraites, liées à la nation, au pays, à la patrie, aux coutumes, aux traditions, à l’Histoire, etc. – auxquelles telle ou telle société ou structure accorde une valeur sacrée alors qu’il ne s’agit en fait que d’éléments non religieux. Sacré et profane sont donc parfois mêlés, pour les sociétés comme pour les États. En France, par exemple, beaucoup confère à Jeanne d’Arc une valeur sacrée, entre sainteté religieuse et patriotisme sacrificiel. Il s’agira de réfléchir aux dynamiques qui poussent à sacraliser ce qui ne l’est a priori pas, comme à jeter un regard profane sur ce qui relève du champ religieux, dans un complexe va-et-vient qui dépend des lieux et des époques. Outre ces phénomènes eux-mêmes (dont il faudra donner des exemples variés), tenter de cerner quels sont les processus de justification et de légitimation qui poussent à la sacralisation du profane, ou au contraire, revêt une importance majeure aux niveaux épistémologique et axiologique. Si l’on dit souvent que les sociétés occidentales sont plus profanes que les sociétés orientales, ce qui est en partie vrai mais aussi en partie faux, ceci mérite de toute façon – une fois de plus – une analyse sérieuse, dans une perspective historique – et comparatiste ! – prenant en compte tous les aspects de la vie humaine, dans la diversité et la contradiction. Pour revenir à l’exemple français (qui devra être enrichi d’autres expériences nationales), les perceptions de la laïcité, malgré le cadre légal, sont multiples et sujettes à discussion. Enfin, une autre question, complexe, est de savoir pourquoi les êtres humains et les sociétés semblent dans l’ensemble avoir plus de difficultés à considérer de manière critique le sacré que le profane.
Lieu : Université d’Al-Azhar, Le Caire.
Date : 9-11 janvier 2024.
Transport et hébergement : à la charge des participants venant de l’étranger.
Transport sur place (dans la mesure du possible, entre l’aéroport et l’hôtel, comme entre l’hôtel et le centre de conférences) et restauration (midi) : à la charge de l’Université d’Al-Azhar.
Comité scientifique :
Ahmad AL-EZABY, professeur, Dpt. D’études islamiques en anglais, directeur du Centre de traduction d’Al-Azhar ; Fouad AL-NADI, professeur (droit public et administratif), Al-Azhar ; Nazir AYAD, professeur (philosophie), secrétaire général du Complexe d’études islamiques – Al-Azhar ; Mervat BAKIR, professeure émérite (littérature française et comparée), Al-Azhar ; Didier GUÉVEL, professeur émérite (droit français privé), Université de Paris 13 ; Soheir HAFEZ, professeur émérite (littérature arabe), Al-Azhar ;
Salwa LOTFI, professeure émérite (littérature arabe), Al-Azhar ; Christian MÜLLER, directeur de recherche (droit musulman), IRHT-CNRS (Paris) ; Abdel Dayem NOSSEIR, professeur émérite, conseiller du Grand Imam d’Al-Azhar ; Denis PERNOT, professeur (littérature française contemporaine), Université de Paris 13 ; Mona SABRY, professeur adjointe, Al-Azhar ; Thomas SZENDE, professeur (linguistique appliquée, linguistique hongroise), INALCO ; Stéphane VALTER, professeur (monde arabe contemporain), Lyon 2 ;
Jim WALKER, professeur (sociolinguistique anglaise), Lyon 2.
Comité d’organisation :
Mona SABRY, Université d’Al-Azhar, monasabry2002@yahoo.fr + mona.sabry@azhar.edu.eg
Stéphane VALTER, Université de Lyon 2, s.valter@univ-lyon2.fr
Calendrier :
Envoi des résumés (environ 200 mots) avec un bref curriculum vitæ aux deux membres du comité d’organisation avant le 1er juin 2023. (Préciser l’axe dans lequel s’inscrit la contribution, comme la langue.)
Réponse du comité scientifique vers le 15 juillet 2023. Programme définitif en octobre 2023.
Les interventions pourront se faire en arabe et en français. Des contributions en anglais et en allemand sont également envisageables (et pourront être accompagnés d’une traduction simultanée vers l’arabe).
Une publication des actes est prévue en arabe et en français (sans exclure a priori les papiers rédigés en anglais et en allemand). Lien : https://cerla.univ-lyon2.fr/activites/colloques-et-journees-detude-2.Contacts : monasabry2002@yahoo.fr + mona.sabry@azhar.edu.eg, et s.valter@univ-lyon2.fr