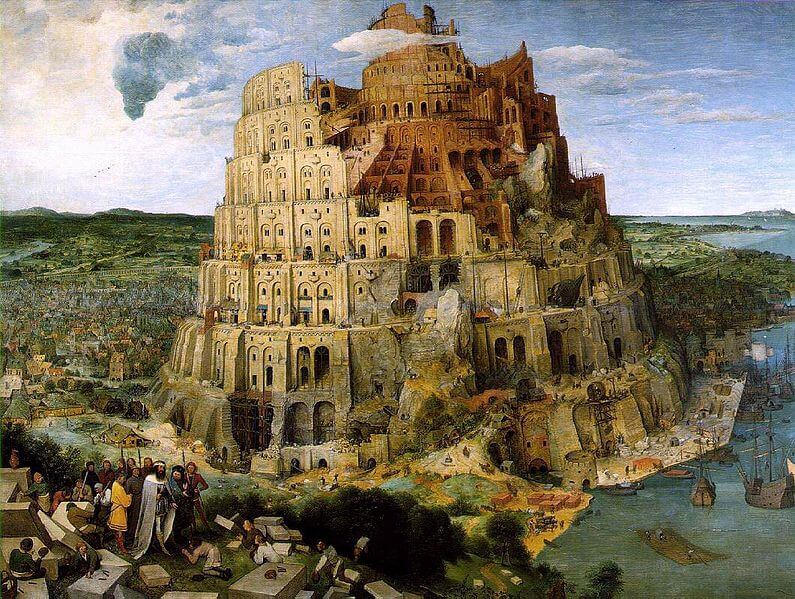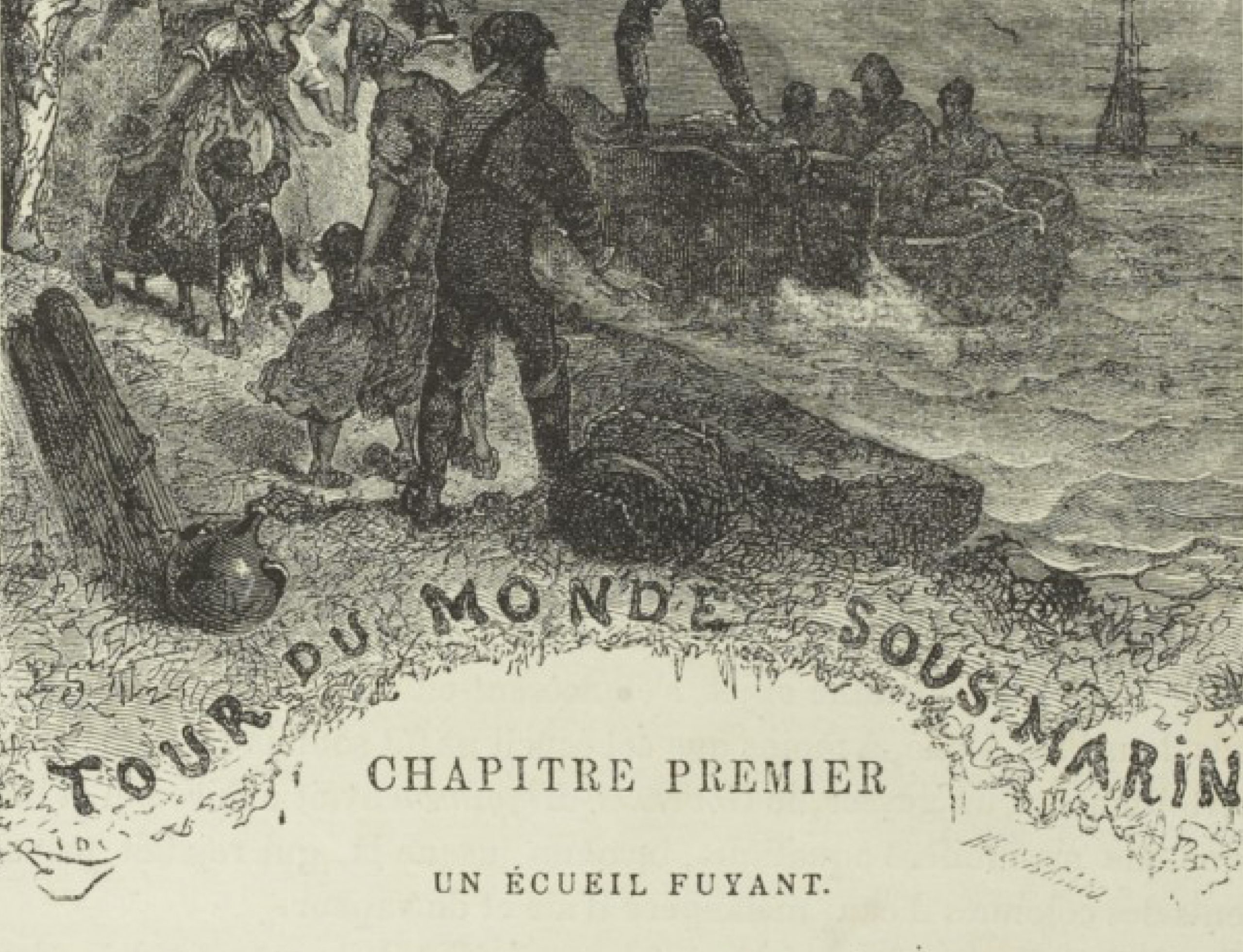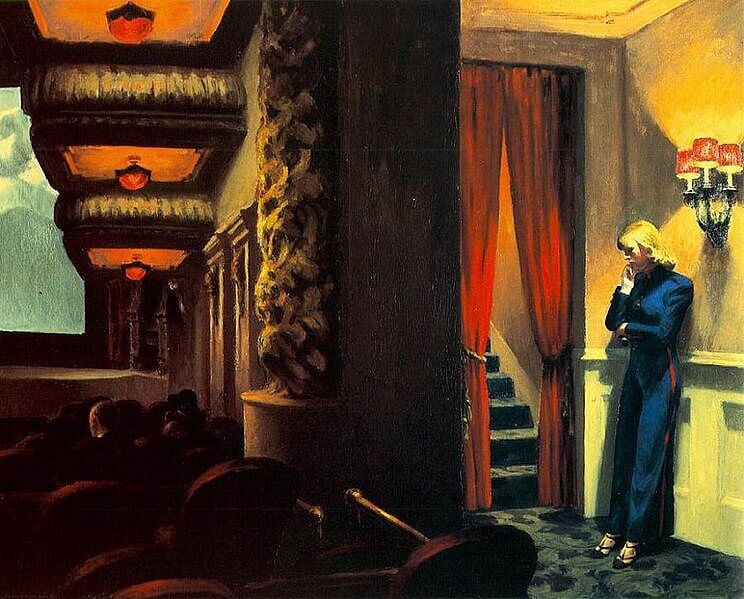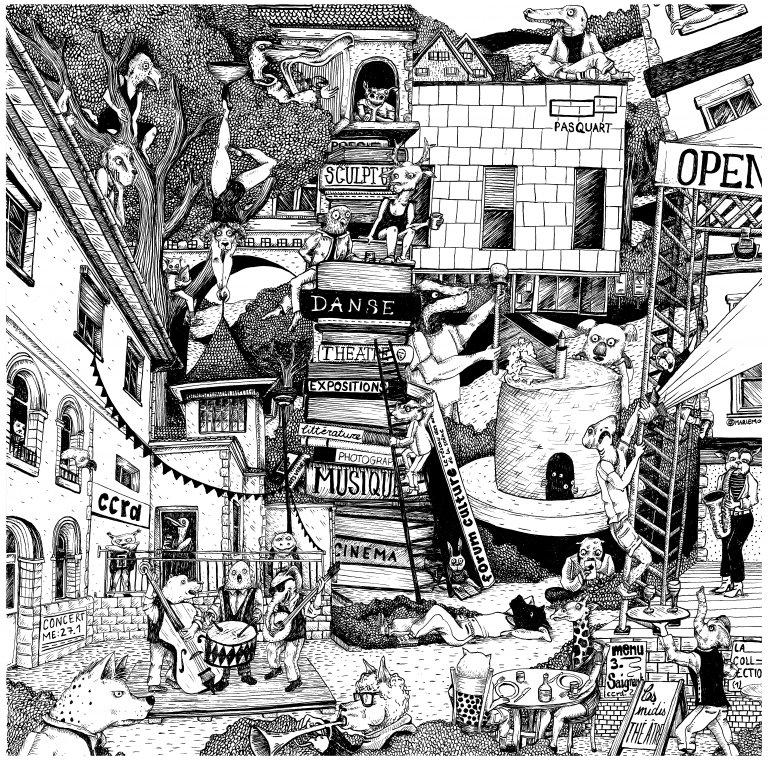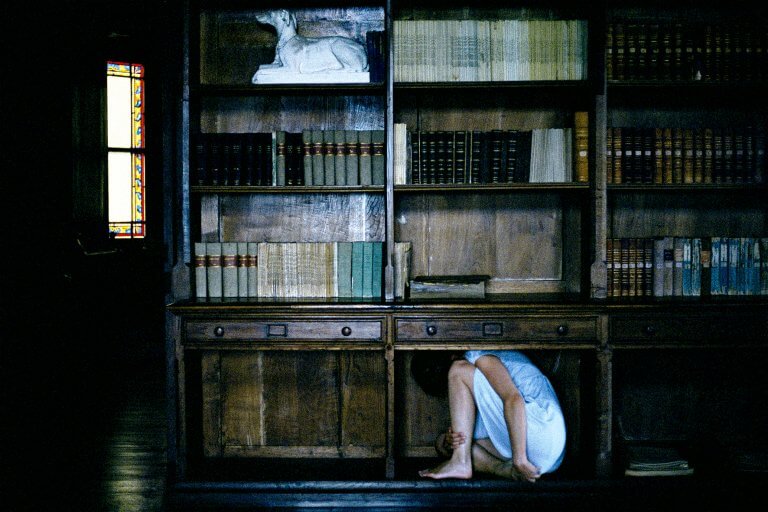Séminaire “Itinéraires de la traduction” (2022-2023) : Séance 1, consacrée aux doctorant.e.s
Séance en mode hybride (voir le lien ZOOM ci-dessous)
PRÉSENTATION
Le séminaire “Itinéraires de la traduction” débuté en 2021-2022 se poursuit cette année, dans le cadre des activités de l’axe 4 de Pléiade.
L’an passé, nous avions organisé trois séances :
– une séance inaugurale, consacrée à la notion d'”itinéraires” dans la circulation des textes traduits, avec les interventions de Camille Bloomfield, Marian Panchón Hidalgo, Aurélie Journo et Cécile Fourrel ;
– une seconde rencontre autour des liens entre traduction et culture de masse, avec Pedro Mogorrón Huerta, Natalia Soler Cifuentes et Céline Planchou ;
– et une dernière séance, consacrée à la “Traduction collaborative”, au cours de laquelle trois expériences de traduction collaborative furent présentées par Cécile Dudouyt, Agathe Torti et les membres de la revue Café, Aurélie Journo, Agathe Bonin et Marie Karas Delcourt.
Nous avons le plaisir de vous convier à la première séance de l’année 2022-2023 qui sera consacrée aux travaux de trois doctorantes.
PROGRAMME
14h. Accueil et présentation par Aurélie Journo et Cécile Fourrel de Frettes
14h15. Alicia Latorre Jara (Université d’Alicante et Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade) : “La traduction audiovisuelle à l’épreuve de l’humour : le cas de Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? et Campeones“.
Discussion
15h. Natalia Soler Cifuentes (Université d’Alicante et Université Sorbonne Nouvelle) : “La marque comme vecteur culturel : étude contrastive français-espagnol d’unités phraséologiques contenant des noms de marques”.
Discussion
15h45. Yiran Wang (Nantes Université) : “L’influence du sexe du traducteur sur la traduction de textes érotiques : une étude des adaptations de romans érotiques chinois par George Soulié de Morant et Lucie Paul-Margueritte”.
Discussion
17h. Clôture de la séance.
La séance sera également accessible via le lien ZOOM suivant :
Cécile Fourrel de Frettes vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Sujet : Zoom meeting invitation – Réunion Zoom de Cécile Fourrel de Frettes
Heure : 5 déc. 2022 02:00 PM Paris
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/93187307781?pwd=ei9mVGpRL3cxNFpvZjVGTEwyWTlBQT09
ID de réunion : 931 8730 7781
Code secret : 330354
Résumés des communications
1. Alicia Latorre Jara (Université d’Alicante et Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade) : “La traduction audiovisuelle à l’épreuve de l’humour : le cas de Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? et Campeones“.
Cette étude a pour objet d’analyser les films Qu’est qu’on a fait au Bon Dieu ? (Philippe de Chauveron, 2014, France) et Campeones (Javier Fesser, 2018, Espagne), en privilégiant la phraséologie et la traduction des références culturelles. L’humour sera l’axe autour duquel je structurerai mon propos en étudiant la succession des Unités Phraséologiques (UP) dans ces deux films.
Dans mon analyse, je rendrai compte des techniques de traduction utilisées en Espagne et en France pour la traduction des éléments humoristiques dans les films mentionnés, puisque mes deux langues de travail sont l’espagnol et le français. Je montrerai donc les contraintes auxquelles est confronté le traducteur. Tout cela permettra de donner une plus grande visibilité aux écueils propres à la traduction de références culturelles à connotation humoristique et d’apporter de possibles solutions de traduction. De cette manière, on verra que l’humour représente rarement un allié pour le traducteur. Enfin, je réfléchirai aux UP qui constituent cette étude dans les deux langues (espagnol et français) et je les classerai selon les critères établis par Martínez Sierra (2009) pour les éléments humoristiques.
2. Natalia Soler Cifuentes (Université d’Alicante et Sorbonne Nouvelle) : “La marque comme vecteur culturel : étude contrastive français-espagnol d’unités phraséologiques contenant des noms de marques”.
Dans les médias, dans la rue, dans les transports, sur le net… Les marques sont omniprésentes et envahissent nos vies quotidiennes. À l’aide du marketing et à travers le discours publicitaire, les marques quittent le milieu marchand pour intégrer l’espace social. Elles deviennent de véritables icônes culturelles, un concentré de notre identité individuelle et collective. Elles pénètrent la sphère sociale et culturelle et, à terme, la sphère linguistique, où les noms de marques intègrent la langue courante et deviennent des noms communs à part entière. Lorsqu’une marque, qui est un nom propre, devient un nom commun ou remplace le nom commun préexistant, cette marque devient générique (Kleenex, Playboy, Coton-Tige, Conguitos, Bollycao…). Les locuteurs s’approprient ces néologismes auxquels ils attribuent de nouveaux sens métaphoriques, donnant ainsi lieu à des expressions figées.
Malgré la florissante création discursive liée aux noms de marque, peu de chercheurs se sont intéressés aux unités phraséologiques comportant un nom de marque. La raison est sans doute le manque de données disponibles, puisque ces expressions ne sont majoritairement pas dans les dictionnaires traditionnels (être un Bounty, tener un pelo Pantene). Elles vont se retrouver à l’oral ou sur les réseaux sociaux.
L’objectif de notre étude est d’analyser et de comparer des expressions figées contentant un nom de marque en français et en espagnol, afin d’analyser ces références culturelles dans les deux langues, à la recherche d’équivalents. Cette étude a vocation de s’élargir à d’autres langues, notamment aux autres langues romaines et aux langues germaniques, en vue de bâtir une base de données d’expressions de noms de marques multilingue.
3. Yiran Wang (Nantes Université) : “L’influence du sexe du traducteur sur la traduction de textes érotiques : une étude des adaptations de romans érotiques chinois par George Soulié de Morant et Lucie Paul-Margueritte”.
Dans la première moitié du XXe siècle, les romans érotiques chinois attirent le regard de certains sinophiles français, notamment George Soulié de Morant (1878-1955) et Lucie Paul-Margueritte (1886-1955), qui réalisent de nombreuses adaptations érotiques avec une touche d’exotisme. Contrairement aux traductions des sinologues, leurs adaptations se combinent avec un jugement subjectif et une imagination personnelle. En d’autres termes, ils sacrifient toujours la fidélité au texte source au profit de l’exotisme, et la Chine dans leurs œuvres n’est pas exempte de stéréotypes.
À travers l’analyse de leurs adaptations de romans érotiques chinois, il n’est pas difficile de trouver certains points communs, par exemple, en ce qui concerne les passages érotiques, ils adoptent souvent l’approche de la réécriture pour embellir les expressions obscènes du texte original et remplacent la traduction des sexes par des métaphores poétiques. Pourtant, nous pouvons également constater certaines différences évidentes, notamment celles causées par le sexe du traducteur. Par exemple, Soulié de Morant fait souvent grand cas de l’habillement et de l’apparence des personnages féminins, et sa réécriture de la fin de l’héroïne révèle certaines morales édifiantes d’un point de vue masculin, tandis que les ajouts de Lucie Paul-Margueritte aux activités psychologiques de l’héroïne et aux descriptions de la masturbation féminine reflètent certaines idées féministes.
Cette communication vise à analyser les caractéristiques des adaptations de romans érotiques chinois par deux traducteurs dans une perspective de genre, afin d’explorer si le genre peut, dans une certaine mesure, déterminer l’orientation du traducteur de textes érotiques.
PROCHAINES SÉANCES
Pour ce nouveau cycle, nous souhaitons orienter la réflexion autour de la question suivante : “Traduction, image et son”.
Vos propositions d’interventions pour les deux prochaines séances qui auront lieu au semestre 2 sont les bienvenues. Les dates ne sont pas encore arrêtées. N’hésitez donc pas à nous écrire pour toute question ou suggestion :
– Aurélie Journo : aurelie.journo@univ-paris13.fr
– Cécile Fourrel de Frettes : cecile.fourrel.de.frettes@gmail.com